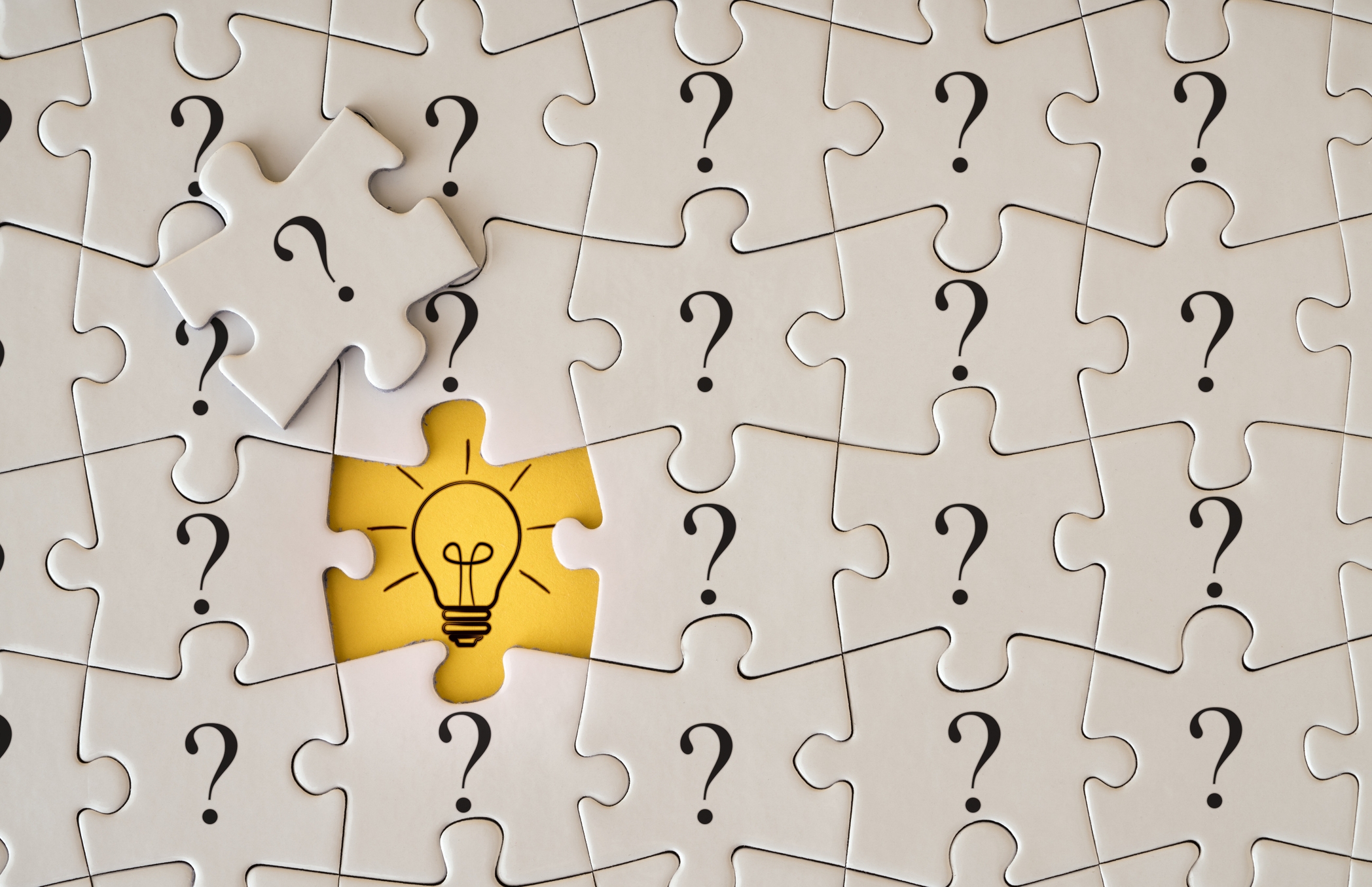Vie personnelle des salaries et droit à la preuve dans les contentieux prud’hommes

Cass.soc. 8 mars 2023, n°21-20.798, 21-17.802, 20-21.848 et n°21-12.492
Cass.soc. 22 mars 2023, n°21-22.852 et 21-24.729
Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle à propos des conditions d’admissibilité dans un contentieux prud’homal de moyens de preuve portant atteinte à la vie personnelle de salariés, notamment lorsqu’ils sont issus d’un dispositif de surveillance qui ne remplit pas toutes les conditions de licéité.
Comme toujours, la Justice doit rechercher ici le délicat équilibre entre :
- D’une part le respect des droits de la personne, notamment de la vie privée et la prévention d’une société du « Big Brother » d’Orwell et,
- D’autre part le droit à un procès équitable et la préservation des droits de la Défense (c’est-à-dire bien souvent l’employeur qui a procédé au licenciement contesté) et donc de son « Droit à la preuve ».
Pour être fine, cette balance est sophistiquée et les critères dégagés ne sont pas aisés à appliquer aux différents cas de figure, notamment disciplinaires, que la pratique quotidienne nous donne de rencontrer.
I. LE PRINCIPE : POUR ETRE ADMISSIBLES EN JUSTICE, LES PREUVES ISSUES DE DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE DES SALARIES DOIVENT ETRE LICITES ET DONC RESPECTER DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui unit le salarié à son employeur, l’entreprise, sans en faire pour autant l’esclave et son maître.
Au temps et au lieu du travail, le salarié est tenu d’une obligation de fournir loyalement la prestation de travail pour laquelle il est rémunéré et l’employeur a le droit (et même le devoir comme cela est souvent rappelé, notamment dans le cadre de son obligation de sécurité et de prévention des risques), d’organiser et de contrôler les modalités d’accomplissement de cette prestation de travail.
Ces concepts ont été forgés au 19ème siècle où le contremaître avait ses équipes « à l’œil ». Mais au 21ème siècle, les salariés sont mobiles, se déplacent en véhicules roulants, travaillent chez les clients, télétravaillent à leur domicile, parfois dans leur résidence secondaire, voire à l’autre bout du monde et sont de plus en plus considérés comme « autonomes ». Les machines ont remplacées les hommes et la surveillance « à l’œil » a laissé place à la « cyber-surveillance ».
De plus, étant donné qu’en droit droit du travail, la règle « Si un doute subsiste, il profite au salarié » s’applique à tout licenciement (article L.1235-1 du Code du travail) et donc que « l’œil » de l’employeur ne suffit pas à prouver, il a donc fallu le remplacer par des machines.
Face à la puissance de ces machines et de leur « intelligence » toute artificielle remplaçant le patron qui surveille et contrôle, le Droit a donc placé des limites à ces outils qui doivent ainsi respecter des conditions :
- sur le fond : ne pas apporter de restriction aux droits et libertés des salariés qui ne soit pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L.1121-1 du Code du travail)
- sur la forme : faire l’objet d’une information-consultation du CSE sur les moyens et techniques mis en œuvre (article L.2312-38 du Code du travail)
- sur la forme encore : être portés à la connaissance des salariés préalablement à leur mise en œuvre (article L.1222-4 du Code du travail)
- sur le fond et sur la forme : respecter les prescriptions du RGPD (Règlement Général de Protection des Données) lorsqu’ils comportement un traitement de données personnelles.
Il s’agit ici notamment des badges d’accès ou de démarrage de machines en tous genres, de la biométrie, des caméras de vidéosruveillance, des dispositifs embarqués à bord des véhicules (géolocalisation, dashcams, …), des systèmes d’enregistrements sonores, des lectures des courriels ou des SMS ou des publications ou messages sur les réseaux sociaux ou messageries instantannées, des vidéos ou messages vocaux enregistrés sur le téléphone, des journaux de connexions informatiques, internet, des keyloggers, des enquêtes, filatures, fouilles, etc.
II. L’EXCEPTION : MEME ILLICITES, LES MOYENS DE PREUVE ISSUS DE DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DES SALARIES SONT RECEVABLES EN JUSTICE S’ILS SONT INDISPENSABLES A L’EXERCICE DU DROIT DE LA PREUVE, S’ILS ONT ETE LOYALEMENT OBTENUS, QUE L’ATTEINTE A LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE EST PROPORTIONNEE AU BUT POURSUIVI ET QUE LEUR REJET RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE EQUITABLE DE LA PROCEDURE
La Cour de cassation a donné plusieurs illustrations des contours de cette exception au cours des 3 dernières années et encore récemment par ces 3 arrêts du 8 mars 2023.
- Des captures d’écran d’un compte privé Facebook du salarié établissant un manquement à son obligation de confidentialité motivant son licenciement sont recevables dès lors que l’employeur n'a eu recours à aucun stratagème pour les obtenir et les a donc obtenues loyalement, l'atteinte ainsi constatée étant donc proportionnée à la protection d'un intérêt particulièrement légitime de l'entreprise. (Cass.soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058)
- Des fichiers de journalisation d’adresses IP non déclarés à la CNIL sont recevables pour prouver une usurpation d’identité fondant un licenciement (Cass.soc. 25 novembre 2020, n°17-19.523)
- Des pièces issues de l’agenda électronique de l’ordinateur professionnel d’une salariée sont recevables si elles ne sont pas identifiées comme étant personnelles par leur auteur (Cass.soc.9 nov. 2022, n°20-18.922)
- Des relevés d’un système de badgeage détourné de sa finalité car installé à l’entrée des bâtiments de l’entreprise et utilisé pour prouver une faute en lien avec les horaires de travail sans jamais avoir été déclaré à la CNIL, au CSE et aux salariés pour contrôler leurs horaires de travail, mais uniquement pour contrôler les accès aux locaux et au parking de l’entreprise, peuvent tout de même être recevables pour prouver la faute de la salariée s’ils sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve par l’employeur et si l’atteinte à la vie personnelle de la salariée est strictement proportionnée au but recherché (Cass.soc. 8 mars 2023, n°21-20.798).
- Des images de la vidéosurveillance mise en place dans un « bar à ongles », illicites car sans autorisation préfectorale pour la période considérée (ce qui est obligatoire dans un lieu ouvert au public en application de l’article L.252-1 du Code de la Sécurité Intérieure) et sans information de la salariée licenciée de sa finalité et de sa base juridique, peuvent tout de même être recevables pour prouver ses détournements de fonds … SAUF si l’employeur dispose d’un autre moyen de les prouver au travers d’un rapport d’audit ayant mis en évidence de nombreuses irrégularités dans l’enregistrement et l’encaissement en espèces des prestations d’onglerie effectuées par la salariée, rapport d’audit que l’employeur n’avait pas versé aux débats, alors qu’il en avait fait état dans sa lettre de licenciement (Cass.soc. 8 mars 2023, n°21-17.802).
S’agissant également d’images de videosurveillance illicite, la Cour de cassation ajoute comme condition à leur examen par les juges du fond que cela lui soit demandé au nom du caractère équitable de la procédure.
L’histoire ne dit pas si le moyen de preuve illicite aurait été jugé recevable ou non comme remplissant les autres critères puisque le pourvoi en cassation de l’employeur a été rejeté, car celui-ci avait simplement soutenu qu’il avait obtenu loyalement un PV d’infraction auprès des services de police alors que :
- Il n’avait pas sollicité et obtenu pour ce faire l’autorisation préalable du Procureur de la République
- Ce PV d’infraction avait été dressé par la police sur le fondement du visionnage de bandes d’enregistrement de la videosurveillance fournies par l’employeur en dehors du cadre fixé par sa charte interne de videoprotection qui interdisait de se servir des images au plan disciplinaire et en dehors des cas d’atteinte à la sécurité des personnes.
Dans cette affaire, le salarié, chauffeur de bus, s’était retrouvé licencié pour faute grave après avoir porté plainte lui-même pour vol de carnets de tickets de transport dans son bus et alors que les services de police avaient récupéré les bandes vidéos de l’employeur où ils avaient constaté que le salarié avait commis des infractions au Code de la Route en téléphonant et fumant au volant (Cass.soc. 8 mars 2023, n°20-21.848)
- S’agissant d’un dispositif de géolocalisation, dont on sait qu’il ne peut servir au contrôle du temps de travail qu’à la condition que le salarié ne soit pas libre d’organiser son travail comme il le souhaite, que l’employeur ne dispose pas d’un autre moyen d’effectuer ce contrôle et que le salarié ait été informé de cette finalité du dispositif, la Cour de cassation vient de confirmer la position de la CNIL (Délibération CNIL 2015-165 du 4 juin 2015), à savoir que le dispositif ne doit pas permettre de localiser le salarié en dehors de son temps de travail (temps de pause ou de trajets privés) et donc qu’il doit être désactivable par le salarié durant ces moments. Dans ces affaires où des salariés avaient été sanctionnés pour avoir utilisé leu véhicule professionnel à des fins personnelles, sur la base de données extraites du du dispositif de géolocalisation, la Cour de cassation a de nouveau jugé que pour que les juges du fond examinent la recevabilité d’une preuve, même illicite, au noù du droit à la preuve, il faut que cela lui soit demandé (Cass.soc. 22 mars 2023, n°21-22.852).
- Dans la seconde affaire, où le salarié avait invoqué la nécessité de se rendre auprès de sa mère malade en fin de journée, ce que l’employeur avait découvert via la géolocalisation initialement destiné à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage et non au contrôle du salarié hors temps de travail, et lui avait reproché au titre des coûts et de la fatigue supplémentaire engendrés, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour n’avoir pas vérifié si l’employeur ne disposait pas d’un autre moyen de contrôle que celui-ci portant atteinte à sa vie privée (Cass.soc. 22 mars 2023, n°21-24.729).
- Ainsi, il n’existe pas de catalogues de preuves recevables ou non, comme on le croit souvent à tort, mais des circonstances bien particulières à chaque fois. C’est du cas par cas.
- Ces arrêts s’inscrivent dans un mouvement plus large de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à réaffirmer le droit à la preuve et à la défense, notamment des employeurs, en admettant la recevabilité de preuves illicites, mais obtenues loyalement, indispensable aux droits de la défense et à l’équité de la procédure. Alors seulement, ces objectifs vont primer sur la protection des droits de la personne du salarié.
III – LE JUGE PEUT ORDONNER LA COMMUNICATION DE CERTAINS BULLETINS DE PAIE POUR ETABLIR UNE INEGALITE DE TRAITEMENT
Un parallèle peut être fait avec cet autre arrêt du même jour de la Cour de cassation où l’atteinte à la vie personnelle s’efface au profit du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes :
- Une salariée est bien fondée à demander, en référé que soit ordonnée la communication des bulletins de salaires d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien dans des fonctions d’encadrement, commerciales ou de marché, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile (Cass.soc. 8 mars 2023, n°21-12.492).
Cette communication était demandée dans le cadre de l’article 145 du Code de Procédure civile, qui prévoit que tout intéressé peut, en cas de motif légitime, demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées les mesures d’instruction nécessaires à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ainsi, là encore, une subtile balance est faite entre l’indispensable droit de la preuve de la personne victime d’une violation du principe fondamental de l’égalité de traitement et, d’autre part, la protection de la vie privée.
Alors même que cette communication de bulletins de paie est, par définition, contraire au RGPD qui protège les données à caractère personnel, le juge y apporte une exception tout en prenant des précautions consistant à circonscrire précisément le périmètre de la communication à certains postes et à ordonner que soient occultées certaines mentions des bulletins.
***
Comme bien souvent en matière judiciaire, tout est affaire de preuves et pas seulement de principes. « Idem est non esse et non probari », autrement dit « Ce qui n’est pas prouvé n’existe pas ».
---------------------
1 Qu’il me soit permis ici de disgresser et de relever que depuis bientôt 27 ans que j’assiste des entreprises et des salariés, le lien de subordination, et donc le contrat de travail et le droit qui l’encadre, me paraissent de plus en plus obsolètes tant ils deviennent quasiment insupportables aux deux parties de ce contrat : aux travailleurs qui rêvent de travailler « à la carte », de souplesse et d’indépendance (ce qu’ils trouvent souvent dans le « consulting », le « free-lance », l’intérim et « l’uber » … toutes formes de précarité que le Droit du Travail n’a eu de cesse de limiter pour mieux les « protéger »), mais tout en bénéficiant de la sécurité et de la protection de l’entreprise et de « garanties » de celle-ci, mais aussi aux employeurs qui rêvent de salariés disponibles « à la demande » (« on demand » comme on dit de la VOD), « autonomes », comptables de leurs résultats et de leur productivité et d’un Droit du Travail aussi souple qu’une variable d’ajustement au marché dans leur équation mathématique financière.
Dans la même thématique
Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un tournant majeur dans sa jurisprudence en considérant qu’un salarié a droit au report de ses jours de congés payés dès lors qu’il n’a pas pu les exercer utilement pour cause d’arrêt de travail survenu pendant la période.
La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, en élargissant le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS).
La garantie des salaires, prévue par la loi, vise à protéger le salarié en prévoyant, sous certaines conditions, le paiement des créances résultant de son contrat de travail lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables
L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :
« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.
Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude
Le Code du Travail réserve un sort différent pour le salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, par rapport au salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.
Cependant, l’appréciation du caractère professionnel d’une inaptitude n’est pas strictement liée à la reconnaissance préalable par l’organisme de Sécurité Sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe souvent oublié est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.